 De gauche à droite : Rousseau, Sarkozy (junior), Apathie, Cambadélis
De gauche à droite : Rousseau, Sarkozy (junior), Apathie, CambadélisQuand les célébrités font des flops littéraires : le revers discret de la notoriété
Publier un livre, quand on est une personnalité publique, semble être devenu un passage obligé. Pourtant, la notoriété ne suffit pas toujours à séduire les lecteurs. Derrière les vitrines bien rangées des librairies, nombre d’ouvrages signés par des figures politiques ou médiatiques se vendent à quelques centaines d’exemplaires à peine. Un paradoxe qui en dit long sur les limites de la visibilité à l’ère médiatique.
Des chiffres qui déchantent
Ils s’appellent Jean-Christophe Cambadélis, Jean-Michel Blanquer, Sandrine Rousseau, Christine Boutin ou encore Marlène Schiappa — autant de noms familiers du paysage politique français. Mais leur popularité n’a pas suffi à faire de leurs essais des succès de librairie. Selon les chiffres publiés par Livres Hebdo et relayés par plusieurs médias, Cambadélis n’a écoulé que 579 exemplaires de son livre, Blanquer 1 037, Rousseau 1 230, Boutin à peine 38 exemplaires de Qu’est-ce que le PCD ? et Schiappa 429 exemplaires.
Plus récemment, Jean‑Michel Aphatie (journaliste) : son livre T’es une merde frère – Signé Hanouna, paru en septembre 2025, aurait vendu moins de 2 000 exemplaires d’après des sources médias. Louis Sarkozy (fils de l’ancien président) : son ouvrage Napoléon Bonaparte : l’Empire des livres s’est vendu à environ 2 131 exemplaires selon la presse.
Ces chiffres peuvent surprendre. Comment des personnalités invitées sur les plateaux de télévision, commentées sur les réseaux sociaux et souvent au cœur de l’actualité, peuvent-elles peiner à trouver un lectorat ? La réponse tient en partie dans la nature du rapport qu’entretiennent les Français avec la parole publique : on l’écoute volontiers… mais on l’achète rarement.
Un phénomène international
Le phénomène n’est pas propre à la France. Au Royaume-Uni, Liz Truss, ancienne Première ministre, a connu une sortie de route similaire : son livre Ten Years to Save the West ne s’est vendu qu’à 2 228 exemplaires en première semaine, malgré une campagne médiatique intense. Aux États-Unis, la comédienne Whoopi Goldberg a confié sa déception après les ventes « catastrophiques » de son autobiographie. Même Arnold Schwarzenegger, habitué aux succès planétaires, n’a pas échappé à la loi du marché : ses mémoires Total Recall n’ont trouvé « que »quelques milliers d' acheteurs à leur sortie, un score faible au regard de son aura internationale.
Autant d’exemples qui rappellent que la célébrité n'attire pas systématiquement le lecteur ou en tout cas ne garantit pas sa fidélité
Les raisons d’un désamour
Des livres perçus comme des outils de communication
La première explication tient sans doute au soupçon qui entoure ces publications. Beaucoup d’essais politiques ou de mémoires de célébrités sont perçus comme des opérations de communication plutôt que comme de véritables projets d’écriture. L’ouvrage devient prolongement du personnage médiatique, un objet promotionnel plus qu’un acte littéraire.
Résultat : le public, méfiant, se détourne.
Une offre saturée
Le marché éditorial est désormais saturé de livres écrits par des personnalités publiques : politiques, animateurs, chefs d’entreprise, influenceurs… Cette inflation rend chaque parution plus anonyme. Le lecteur, bombardé d’entretiens et de tribunes, a souvent l’impression d’avoir déjà « tout entendu » avant même d’ouvrir le livre.
La lassitude politique et le timing
Le moment choisi pour publier joue aussi un rôle décisif. Sortir un essai après une défaite électorale ou une polémique donne souvent le sentiment d’une justification tardive. Le lecteur n’y voit qu’un règlement de comptes ou une tentative de réhabilitation. Ainsi, les ouvrages de Blanquer ou de Truss ont souffert d’un contexte défavorable : trop proches d’une période de crise pour susciter la curiosité sereine du public.
L’écart entre notoriété et légitimité littéraire
Être connu ne signifie pas être crédible dans tous les domaines. Le lecteur français, notamment, demeure attaché à la qualité de l’écriture, à la sincérité du propos et à la densité des idées. Une notoriété purement médiatique, sans réelle profondeur littéraire, se heurte à cette exigence. Comme le résume un éditeur parisien : « Les gens n’achètent pas un nom, ils achètent une voix. »
Une notoriété devenue handicap ?
Paradoxalement, la célébrité peut se transformer en fardeau. Les attentes sont plus fortes, le regard plus critique. Là où un auteur inconnu bénéficie d’une curiosité bienveillante, la figure publique doit convaincre un lectorat qui la connaît déjà. Avec défiance, le public choisit souvent de ne pas franchir la porte de la librairie.
À cela s’ajoute l’effet des réseaux sociaux : la parole politique ou médiatique s’y consomme gratuitement, immédiatement. Pourquoi acheter un essai quand on peut suivre en temps réel les opinions de son auteur sur X, Instagram ou YouTube ?
Lire, un acte d'engagement
Derrière ces chiffres modestes se cache peut-être un constat plus profond : lire demeure un acte exigeant, presque intime. Acheter un livre, c’est accorder sa confiance à une voix, accepter de lui consacrer du temps et de l’attention. Or, dans un monde saturé de discours, cette confiance ne se décrète pas. Elle se mérite.
Les « flops » littéraires de Jean-Christophe Cambadélis, Jean-Michel Blanquer, Sandrine Rousseau, Christine Boutin, Liz Truss, Whoopi Goldberg ou Arnold Schwarzenegger ne sont donc pas de simples accidents de parcours : ils disent quelque chose de notre époque. Une époque où la visibilité ne vaut plus légitimité, et où l’exposition médiatique n’assure pas le client.
Le “bide littéraire” des personnalités célèbres ne relève pas d’un simple accident commercial. Il témoigne d’une mutation du champ éditorial, où la reconnaissance du talent et de la nouveauté prime sur la notoriété.
L’acte d’achat d’un livre reste profondément lié à la curiosité intellectuelle. Or, dans une société de communication instantanée, la lecture longue, exigeante demeure un geste sélectif que la notoriété seule ne suffit plus à susciter.
Plus encore, la célébrité peut devenir un handicap : elle crée une attente disproportionnée et expose l’auteur à un jugement plus sévère.
Les lecteurs s’autorisent davantage à ignorer un livre dont ils estiment avoir déjà entendu “l’essentiel” dans les médias.
Vous avez un livre dans votre tiroir ?
Publier gratuitement votre livre
Vous avez écrit un livre : un roman, un essai, des poèmes… Il traine dans un tiroir.
Publiez-le sans frais, partagez-le, faites le lire et profitez des avis et des commentaires de lecteurs objectifs…
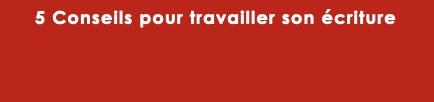
@Odyssée des Idées
Ce que vous dites est globalement exact.
On ne peut pas généraliser sur les médias et l’appropriation du fait culturel par la gauche, même si la droite a toujours été timide sur le sujet.
Et il existe de nouveaux médias — télé, presse, ainsi que quelques écrivains — qui soutiennent des thèses d’opposition. Quand des parts de marché sont à prendre, le capitalisme fait feu de tout bois…
Même si de lourdes menaces pèsent contre ces médias. Procès et labels de "bien-pensance" parfaitement d'actualité..
Concernant la dette, bien que je ne sois pas expert, je me demande si ce n'est pas une opportunité pour le pouvoir. Un État ne peut pas être en faillite, il lui suffit de prendre dans la poche des petits propriétaires, sur lesquels s’abattent toutes sortes de taxes.
Sous Franco, qui avait compris que les propriétaires de leur logement sont dociles, l'Espagne avait le plus fort taux d'Europe à l'époque. On ne fait pas la révolution quand on a une maison.
Globalement, on peut distinguer trois entités sociologiques :
1) Les "Nowhere" de nulle part, sans attaches réelles... bobos, financiers, hommes d’affaires, retraités aisés vivant à l'étranger, diplômés capables de travailler ailleurs, de voyager, de déplacer leur fortune, de s’exiler… et qui sont difficiles à taxer.
2) Les "Somewhere", la classe moyenne, petits propriétaires, artisans, commerçants, salariés, fonctionnaires, paysans, ruraux attachés à leurs racines, leurs biens et leur famille qui ne peuvent quitter le pays, piégés par leurs maisons, l'absence de diplômes reconnus et de maîtrise de l’anglais. Ils devront s’acquitter de la dette, bon gré, mal gré. Taxes sur les carburants, la consommation, l’habitat…
3) Les "Outwhere", venus d'ailleurs... populations immigrées, d'abord appelées pour remplacer les ouvriers, et qui peinent à trouver des emplois dans une France désindustrialisée et donc à intégrer la communauté nationale, faute de pouvoir devenir de petits propriétaires.. Des populations en souffrance dont l’imaginaire est partagé entre le pays d’accueil et celui d’origine. Ils participeront difficilement au règlement de la dette, puisqu'ils sont mouvants, ont des revenus variables et passent souvent sous les radars...
Leur présence est une opportunité pour le pouvoir qui les oppose souvent aux somewhere : diviser pour mieux régner.
La gauche radicale qui a perdu l'électorat populaire, et qui sait qu’elle n’accédera jamais au pouvoir, en fait un électorat de substitution pour obtenir des postes d’élus lucratifs et se placer en faiseuse de rois. Elle contribue à les maintenir dans un état victimaire et précaire désignant les "Somewhere" comme les responsables de leur non intégration et instillant un climat conflictuel permanant.
Les seuls qui payeront la dette seront donc les "Somewhere", les classes moyennes. D'où leur révolte électorale et le succès des trois auteurs précités et l'échec des autres, pour en revenir au sujet de départ...
Ce débat est effectivement extrêmement intéressant et je vous remercie pour la qualité de vos propos, de vos arguments, de vos informations.
J'espère juste que vous n'êtes pas trop optimiste en pensant que notre débat puisse intéresser...
Bien à vous.
@Café littéraire
Merci pour cette réponse dense — c'est précisément ce type d'échange qui rend les forums intéressants.
Votre analyse des "plaques tectoniques" est stimulante. Je partage une partie du constat : oui, une certaine gauche culturelle s'est embourgeoisée et a troqué l'analyse contre l'incantation morale. Oui, l'argument du "retour des heures sombres" s'épuise à force d'être brandi sans discernement. Oui, les réseaux sociaux ont brisé un monopole. Sur ces points, nous sommes d'accord.
Mais permettez-moi de pointer plusieurs asymétries dans votre tableau.
Sur le "pouvoir culturel"
Votre thèse suppose que le pouvoir économique et le pouvoir culturel seraient distincts — la bourgeoisie tenant l'un, la gauche l'autre. La réalité est plus enchevêtrée.
D'un côté, oui, les médias publics ne sont pas neutres : le jeu des nominations, un certain entre-soi sociologique, une France jacobine et parisienne qui peine à entendre ce qui gronde en périphérie — tout cela existe. Je ne le nie pas.
Mais de l'autre, qui possède les maisons d'édition, les chaînes privées, les magazines ? Cette frontière pouvoir économique / pouvoir culturel est bien plus poreuse que vous ne le suggérez. Et depuis quinze ans, un projet de reconquête culturelle très explicite est à l'œuvre. Les "quelques médias non mainstream" que vous évoquez — CNews, Europe 1, le JDD, Paris Match — appartiennent à un même groupe, piloté par un homme qui assume publiquement une ligne idéologique. Ce n'est pas une brèche : c'est une stratégie industrielle.
Autrement dit : le conformisme mou des uns ne justifie pas l'offensive assumée des autres. Les deux méritent critique — mais ils n'opèrent pas de la même manière.
Sur le "peuple idiot" Je n'ai jamais suggéré cela — et je refuse ce procès d'intention. J'ai parlé de cadrage, ce qui est très différent. On peut être parfaitement intelligent et voir son attention focalisée sur certains sujets plutôt que d'autres. Le ratio AME/évasion fiscale (1,3 milliard contre 60 à 100 milliards) n'est pas une opinion — c'est un fait. La question n'est pas l'intelligence du public, mais le temps d'antenne accordé à l'un et à l'autre. Qui décide de ce temps ?
Sur Brecht Vous citez "Si le peuple vote mal, il faut remplacer le peuple." Ironie mordante, en effet. Mais Brecht visait le pouvoir est-allemand — un régime qui se réclamait du peuple tout en l'écrasant. L'ironie ne portait pas sur la démocratie, mais sur ceux qui parlent au nom du peuple pour mieux le domestiquer. N'est-ce pas précisément ce que font certains tribuns médiatiques aujourd'hui — de tous bords ?
Sur l'équilibre Je ne défends aucun camp. Je critique tout autant les discours qui, à gauche, brandissent les "heures sombres" sans analyser pourquoi le terrain leur échappe. L'incantation morale n'est pas plus une analyse que la désignation de boucs émissaires. Les deux évitent la question des mécanismes.
Sur Hugo et Zola Hugo savait émouvoir, bien sûr. Mais relisez Les Misérables : derrière Gavroche, il y a une dissection du système pénal, de la misère structurelle, de l'hypocrisie bourgeoise. L'émotion servait l'analyse, pas l'inverse. C'est cette articulation — colère transformée en conscience des mécanismes — que je ne retrouve pas, à mes yeux, chez les auteurs que vous citez.
La question que je pose n'est pas partisane. Elle est méthodologique : quand un discours nomme une souffrance sans en analyser les causes structurelles, que produit-il ? De l'émancipation — ou de la canalisation ?
C'est précisément ce que j'ai essayé d'explorer dans Dette publique : qui paie vraiment ? — non pas pour désigner des coupables, mais pour rendre visibles les mécanismes que le débat public laisse dans l'ombre : qui paie les 66 milliards d'intérêts annuels, pourquoi certains sujets saturent l'antenne pendant que d'autres restent inaudibles, comment la colère légitime est orientée.
Mais on s'éloigne de l'article initial — et ce format de commentaire ne permet pas d'aller beaucoup plus loin. Je vous laisse le mot de la fin si vous le souhaitez.
Merci pour cet échange — il est rare d'en avoir d'aussi stimulants.
@Odyssée des Idées
Merci pour cette réponse extrêmement intéressante, qui en appelle une autre, certes complexe.
Le pouvoir, les élites, la bourgeoisie ont compris depuis longtemps que, de par le système électoral, censitaire du temps de Hugo et de Zola, dont le peuple était exclu, ils ne pourraient se maintenir durablement au pouvoir. Car, mathématiquement, le bas de la pyramide est plus peuplé.
Deux solutions s’offraient donc :
La première : évoquer les fantômes lugubres du passé, diffuser la peur. Le maître des peurs est le maître du pouvoir…
Cela a fonctionné pendant un demi-siècle, mais l’argument, mille fois ressassé, s’est épuisé. Il a atteint ses limites quand de nouvelles angoisses, de nouvelles peurs que le peuple appréhende concrètement se sont profilées. Les mythes du passé, le spectre des cendres fumantes qui pourraient se réactiver, ne fonctionnent plus.
Seconde solution : après la guerre, la bourgeoisie financière, qui détient le pouvoir réel, a passé un pacte avec les partis d’opposition, leur abandonnant le pouvoir culturel : enseignement, littérature, presse, édition, du spectacle... et en leur accordant des emplois réservés, des quartiers chics, des appartements sécurisés, des coles privées, de jets privés, des cocktails mondains... Les fameuses élites boboïsées du show bizz, Souchon en tête, dont l'objectif est d'endosser les habits de la gauche historique, pour culpabiliser ceux qui voteraient « mal » et donner aux gentils électeurs l’illusion d’être de petits résistants. «No pasarán". Une rente mémorielle qui n'a rien à envier à celle de l'Algérie.
Mais cet argument aussi a atteint ses limites. À force de crier au loup...
Troisième point : les médias "mainstream" : télévision, presse financée par l’État, qui avaient jusqu’ici la main sur « le bon peuple » sont désormais concurrencés par les réseaux sociaux qui diffusent une information alternative.
D’où l’effroi palpable et les tentatives récentes de museler ce nouveau média, les réseaux sociaux, à la veille des élections, avec l’argument du complotisme.
D'autant que quelques médias non "mainstream", télé ou presse, se sont glissés dans la brèche et permettent aux trois auteurs cités de trouver un lectorat populaire, quand celui à la gloire des "officiels" s'effondre. Ce qui est le sujet de l'article.
L’assiette au beurre bascule. Il faudra nous y faire.
Ultime alternative, "si le peuple vote mal, remplacer le peuple" disait Brecht. Mais quand les plaques tectoniques bougent, si elles ne peuvent glisser, elles se fracturent. Le système étant aveugle, c'est ce qui se produit souvent : "shut down" (nous y sommes), guerre civile, révolution…
PS 1 : je ne suis nullement un militant, je ne suis engagé nulle part, juste un observateur, passionné par l'histoire et la culture, qui essaye d'être lucide...
PS 2 : ne croyez pas que je fasse l'impasse sur votre argument des "enjeux cachés", simplement qu'en démocratie, il est difficilement recevable, puisqu'il supposerait que les lecteurs, les électeurs sont idiots et ont besoin d'être éduqués, rééduqués...
@Café littéraire
L'analogie avec Hugo et Zola est séduisante — et je comprends pourquoi elle parle. Ces auteurs ont mis des mots sur une souffrance que les élites ignoraient. Qui ne voudrait pas être du côté de Gavroche ?
Mais déroulons l'analogie jusqu'au bout.
Hugo ne se contentait pas de nommer la souffrance. Il en désignait les causes : un système qui broie. Zola ne désignait pas un bouc émissaire — il défendait le bouc émissaire contre la meute. Et tous deux ont payé le prix : exil, procès, opprobre.
C'est là que l'analogie mérite examen.
Qui joue Gavroche aujourd'hui dans le récit des auteurs que vous citez ? Qui joue Dreyfus ? Et surtout : quel prix paient-ils ? Villiers, Zemmour, Bardella bénéficient d'une exposition massive — prime time, couvertures, relais constants. Ils se présentent en résistants, mais Hugo et Zola affrontaient le pouvoir et la presse dominante de leur époque. Eux bénéficient du soutien d'un pouvoir médiatique considérable.
Je ne dis pas cela pour disqualifier leurs lecteurs — la souffrance qu'ils captent est réelle, l'angoisse des parents est réelle, le sentiment de dépossession est réel. Mais capter une souffrance et en identifier les causes sont deux choses différentes.
Vous avez raison : le mépris des élites existe, et Mnouchkine a raison de le nommer. Mais dénoncer ce mépris ne valide pas automatiquement ceux qui prétendent parler au nom du peuple. On peut être méprisé par en haut et instrumentalisé par ailleurs.
Hugo et Zola nageaient à contre-courant — face au pouvoir, face à la presse dominante. Aujourd'hui, quel est le courant dominant ? Qui possède les antennes ?
La question n'est pas de savoir si ces auteurs sont "de droite" ou "de gauche" — ce clivage ne m'intéresse pas ici. La question est : leurs livres aident-ils à comprendre les mécanismes qui produisent cette souffrance — ou orientent-ils la colère vers des cibles qui arrangent d'autres intérêts ?
C'est une question, pas un verdict.
@Odyssée des idées
Peut-on mettre sur le même plan la taxation des profits et l'angoisse des parents ?
Hugo, Zola ont été révolutionnaires parce qu'ils ont dénoncé l'injustice, l'antisémitisme...
Pour les élites de l'époque, leur message était inaudible.
Le mépris dans lequel les élites intellectuelles et bourgeoises actuelles tiennent le peuple explique qu'il se raccroche à ceux qui comprennent sa souffrance... Comme Hugo comprenait Gavroche et Zola comprenait Dreyfus... Deux exclus.
Tout est dans la lettre d'Ariane Mnouchkine, cette artiste d'une intelligence, d'une honnêteté et d'une lucidité rares, qui dénonce ce mépris.
Les vrais artistes et les grands écrivains nagent toujours à contrecourant.
@Michel CANAL @Café littéraire
Votre échange touche juste, au-delà des clivages partisans habituels.
Vous mettez le doigt sur un point déterminant : Villiers, Zemmour, Bardella ne séduisent pas par hasard. Ils vendent parce qu'ils résonnent avec un malaise bien réel. Des millions de Français sentent que quelque chose ne tourne plus rond. Travailler plus, vivre moins bien, voir l'hôpital craquer — et avoir l'intuition que les règles du jeu se décident ailleurs.
Ce malaise est légitime.
Mais voici la distinction décisive : nommer un malaise, ce n'est pas encore en comprendre la mécanique. On peut avoir raison sur le symptôme et se tromper sur le diagnostic.
L'immigré est visible. Le voisin qui "profite" est visible. Mais les 66 milliards d'intérêts de la dette versés chaque année à des créanciers anonymes ? Invisibles. Sans visage. Sans antenne.
L'AME coûte 1,3 milliard €. L'évasion fiscale, entre 60 et 100 milliards €. Rapport de 1 à 60. Lequel occupe le plus de temps d'antenne ?
Ce n'est pas une question de droite ou de gauche. C'est une question de cadrage. Le cadrage oriente la colère. La colère cherche des mots. Et les mots qui la nomment deviennent des best-sellers.
Cette indignation est fondée. La question est : vers quoi est-elle dirigée — et qui a intérêt à ce qu'elle ne le soit pas ailleurs ?
Les auteurs que vous citez ont du succès parce qu'ils nomment ce malaise. C'est leur force. Reste à savoir si leurs livres éclairent les mécanismes — ou s'ils fournissent surtout des coupables commodes.
@Michel CANAL
J'approuve votre analyse.
Sauf à dire que le peuple, les Français (74% pour Bardella contre 26% pour Mélenchon) sont des abrutis, des crétins, des ignorants... Et dans ce cas, écrivait Bertolt Brecht : "si le peuple vote mal, il faut remplacer le peuple"...
@Café littéraire, je pense que les trois cités (Philippe de Villiers, Eric Zemmour et Jordan Bardella) dont les livres publiés connaissent un grand succès, disent — et l'ont écrit —, ce que les Français ont envie d'entendre : une vérité que les médias du service public et de gauche, par ailleurs subventionnés avec l'argent des contribuables, édulcorent quand ils ne la taisent pas.
Concrètement, on retrouve chez ces personnalités l'information qui a valu un conflit aux médias du groupe Bolloré, orientés plutôt à droite, avec le résultat récent que l'on connaît : le pschitt du procès intenté contre Cnews, la première chaîne d'information ayant été accusée de contourner les règles de pluralisme. L'Arcom a étrillé le rapport biaisé de Reporters sans frontières.
@Sylvie de Tauriac
Oui, sans doute, l'abus d'images et d'information...
Mais comment expliquer que certains vendent très bien ?
Parce qu'ils parlent du réel ? Qu'ils ont rompu avec la langue de bois ? Qu'ils disent la vérité ?
La question est posée. À tourner autour du pot, ne sommes-nous pas dans le déni ?
Essayons au moins de trouver une explication à leur succès, même dévalorisante...
Je suis preneur, sincèrement...
Votre article est passionnant. Il faut tout de même ajouter que les gens n'ont plus de curiosité intellectuelle, ils préfèrent les images et les émotions fortes. L'effort intellectuel est boudé car trop exigeant. Cela dit, les personnalités politiques qui ont échoué ne peuvent écrire que des fiascos littéraires. @Sylvie de Tauriac
Article très intéressant.
Article très intéressant que "Les grands flops littéraires de célébrités", une analyse assez bien observée, judicieusement complétée par le commentaire de @Odyssée des Idées, notamment par la citation d'autres personnalités dont les ouvrages connaissent un succès très différent.
Je n'ai rien à ajouter, outre l'assentiment à cette analyse et à son complément.
Merci @monBestSeller, pour cet article objectif, instructif, dans le rôle d'une plate-forme d'auteurs.
MC
La réponse n'est-elle pas dans la question ?
Pourquoi parler des "has been" qui n'intéressent personne, à qui on a trop longtemps laissé croire qu'à défaut d'avoir du talent, ils présentaient un quelconque intérêt et évoqué mille excuses pour expliquer leur échec dont la seule raison est leur vacuité...
Pourquoi ne pas parler des premiers qui sont Bardella, Zemmour & de Villiers, qui vendent par centaines de milliers et touchent le cœur des lecteurs et leur bon sens...
Y aurait-il deux catégories de lecteurs, l'élite et les Français ?
Tout est dans la lettre d'Ariane Mnouchkine qui explique parfaitement ce mépris pour le peuple…
La notoriété ne fait plus vendre ? Oui, mais…
L'article met le doigt sur un phénomène réel : des personnalités omniprésentes dans les médias peinent à écouler quelques centaines d'exemplaires. Les chiffres cités — Cambadélis à 579, Boutin à 38, Schiappa à 429 — sont effectivement saisissants. Mais ils méritent d'être replacés dans un contexte plus large pour comprendre ce qu'ils révèlent vraiment.
Le marché du livre est structurellement polarisé
Ces « flops » ne traduisent pas un rejet global des livres de personnalités, mais une concentration extrême des ventes sur quelques titres. Dans le même rayon, Jordan Bardella dépasse les 200 000 exemplaires chez Fayard, Éric Zemmour avoisine les 280 000 avec La France n'a pas dit son dernier mot. Autrement dit, la même mécanique éditoriale — gros tirage, plan média massif — produit des résultats diamétralement opposés selon les titres.
Ce qui distingue les succès des échecs ? Trois éléments semblent déterminants : une promesse narrative claire (récit identitaire, dénonciation, solution à un malaise collectif), un timing porteur (campagne électorale, moment de crise), et une cohérence entre l'auteur et son propos. Les livres perçus comme des justifications post-défaite ou des bilans techniques souffrent d'un déficit de désir : ils n'offrent ni espoir, ni colère structurée, ni « roman » personnel suffisamment fort.
2 000 exemplaires : échec ou normalité ?
Il faut aussi rappeler une réalité souvent méconnue : le tirage moyen d'un livre en France tourne autour de 7 000 exemplaires, mais ce chiffre masque d'énormes disparités. Pour les essais politiques « ordinaires », 3 000 à 4 000 exemplaires constituent déjà un horizon respectable. Dans ce contexte, 1 500 ou 2 000 ventes ne sont pas un « scandale statistique » — c'est un score modeste pour une figure médiatique, mais parfaitement banal rapporté à la masse des publications.
Cela dit, l'article a raison de pointer le décalage : quand on bénéficie d'une exposition télévisuelle quotidienne et qu'on peine à convaincre 500 lecteurs, c'est bien que quelque chose ne fonctionne pas dans la conversion de la visibilité en lectorat.
La vraie question : qu'est-ce qui a changé ?
L'article suggère une « mutation » du rapport à la parole publique imprimée. Mais est-ce vraiment nouveau ? Les essais politiques ont toujours été un genre à risque, avec quelques succès retentissants et une masse de titres confidentiels. Ce qui semble avoir changé, c'est peut-être moins le public que l'offre : inflation des publications de personnalités, accès gratuit et immédiat à leurs opinions sur les réseaux sociaux, saturation médiatique qui donne l'impression d'avoir « déjà tout entendu ».
Dans ce contexte, acheter un livre devient un acte plus exigeant. Le lecteur n'achète pas un nom — il achète une promesse de découverte, d'approfondissement, de surprise. Et cette promesse, la notoriété seule ne suffit plus à la garantir.
En résumé
Les « bides » de célébrités ne signent pas la mort du livre politique. Ils révèlent une sélection devenue impitoyable, où seuls percent les ouvrages qui proposent un vrai récit, au bon moment, porté par une voix crédible. La question qui reste ouverte : cette polarisation est-elle une fatalité, ou les éditeurs peuvent-ils encore créer la surprise en misant sur des propositions moins attendues ?
Sources : Livres Hebdo, GfK, chiffres de ventes cités par Actualitté et L'Express.
Et dire que je me sentais ridicule avec 3400 visites : je peux relativiser !